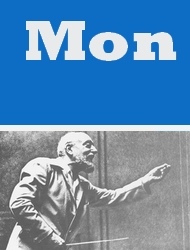Ernest Ansermet sur sa vie
Une causerie tenue le 15 mai 1965 à Chambésy
sur l'invitation du professeur René Mach
Ce portrait d'Ernest Ansermet est cité du bas de la photo publiée en page 9 de l'ouvrage «Les grands Interprètes - Ernest Ansermet», Portraits de Jean Mohr, Texte de Bernard Gavoty, critique musical du «Figaro», Éditions René Kister - Genève (couverture reproduite à gauche). Cette superbe petite brochure richement illustrée est hélas épuisée depuis bien longtemps, mais on la trouve encore assez facilement dans les bibliothèques publiques, ainsi qu'en vente sur certaines plateformes d'antiquaires livres bien connues, par exemple ZVAB, AbeBooks.
Ce portrait n'a pas été pris lors de la causerie présentée ci-dessous, mais illustre certainement tout-à-fait la joviale humeur que devait avoir Ernest Ansermet lors de cette causerie!
Ernest Ansermet dans une longue causerie, savoureuse, pleine de souvenirs et d'anecdotes: c'était le 15 mai 1965, il était invité à Chambésy par son médecin et ami le professeur René S. Mach (*), pour raconter ses souvenirs devant une assemblée de médecins de la Clinique médicale thérapeutique de Genève. Cette causerie est très inhabituelle car Ernest Ansermet n'aimait pas beaucoup parler de lui. L'entretien fut ensuite diffusé à la radio.
L'enregistrement présente quelques défauts car j'ai récupéré cette causerie d'une de mes plus anciennes cassettes, enregistrée dans mes jeunes années. Mais c'est un document très précieux, car il contient beaucoup de détails de sa vie qui sont autrement difficiles à trouver. J'ai réparti le tout sur plusieurs fichiers, afin d'en faciliter l'écoute, resp. la lecture.
La transcription du texte cité ci-dessous a été un peu arrangée, et j'ai inséré quelques sous-titres caractérisant les divers points-forts de la causerie.
(*) "[...] René Mach entreprend des études de médecine à Berne d’abord, puis à Genève où il passera sa vie. Pour lui, le médecin doit surtout être à l’écoute du malade et privilégier la médecine clinique, car sur elle s’établit le diagnostic qui ne saurait être remplacé par la technologie. Parallèlement à son activité de médecin soignant, il entreprend avec son épouse, Evelyne Mach-Perrot, des recherches dans un domaine qui les passionne: le métabolisme du sel. Préoccupé aussi de questions éthiques, il affirme que le prolongement de la vie n’est pas une fin en soi et qu’il faut éviter l’acharnement thérapeutique. Enfin il évoque la figure d’Ernest Ansermet, dont il fut le médecin et l’ami. [...]"
Cité de la page Plans Fixes présentant leur vidéo réalisée avec René Mach (Interlocuteur: Prof. Charles Durand, Numéro de film: 1067, Film 16 mm noir & blanc. Durée env. 50 mn., Tourné le 11/07/1989 à Genève)
Cliquer sur les titres ci-dessous pour lire les textes des fichiers audio!
1. Je n'ai jamais pensé qu'à la musique...
"[...] Le professeur Mach m'a demandé de vous raconter quelques souvenirs. On me l'a souvent demandé, on m'a souvent suggéré d'écrire mes mémoires et on s'est étonné que je ne les écrive pas. Je dois vous dire qu'en effet, je n'ai jamais fait de conférence comme celle-ci, et je n'ai jamais songé à écrire des mémoires. Parce que, autant il m'est aisé de parler de musique, de méditer sur la musique philosophiquement, techniquement ou esthétiquement, autant je me sens peu apte au récit, notamment à l'anecdote.[...]"
Peu apte aux anecdotes...
"[...] Une fois qu'à New York, un journaliste venait m'interroger et me disait: M. Ansermet, racontez-moi une anecdote sur votre carrière, je lui ai répondu: Ecrivez dans votre article: cet artiste n'a pas d'anecdote, et c'est ce qui le caractérise. Cependant, je désire répondre à votre invitation... Alors, en pensant précisément à ma vie, ce qui me frappe d'abord, et ce qui me frappe le plus, c'est le rôle qu'y a joué le hasard. [...]"
J'aurais raté ma carrière...
"[...] Si, par exemple, entre ma 16e et ma 18e année, je n'avais pas eu, deux graves pleurésies, qu'on appelait à ce moment-là pleurésies sèches et dont il me reste des traces, je n'aurais pas été dispensé du service militaire pour cause de «faiblesse générale» (comme dit mon livret de service). Et si je n'avais pas été dispensé du service militaire, j'aurais dû faire la mobilisation de 14-18, qui a été exactement le moment où ma carrière a pu se nouer. C'est-à-dire que j'aurais raté ma carrière. [...]"
Depuis ma tendre enfance...
"[...] Si, d'autre part, je n'avais pas été, d'abord, professeur de mathématiques, beaucoup de choses ne se seraient pas passées. On a souvent dit que j'avais été un mathématicien qui, à un moment donné dans sa vie, s'était tourné vers la musique. C'est complètement faux! J'étais musicien bien avant d'être mathématicien, j'étais musicien depuis ma tendre enfance. Je n'ai jamais pensé à autre chose, je peux le dire, dans mon enfance et mon adolescence, qu'à la musique. J'ai vécu dans les nuages, à ce moment-là, parce que précisément, je ne rêvais qu'à la musique. Lorsque, au Collège de Vevey, nous avions des leçons d'histoire, il y avait là un professeur qui avait l'habitude de dire aux élèves: Retenez bien ceci... et il ajoutait: Je ne dis pas ça pour Ansermet, car je sais que c'est inutile. [...]"
Une famille de paysans musiciens...
"[...] Ma mère était musicienne, mon père avait une très belle voix; mais surtout ma famille maternelle, qui était faite de paysans de Mont-la-Ville, était une famille de paysans musiciens. Mon arrière-grand-père était chef de la musique militaire de Morges, et il descendait régulièrement de Mont-la-Ville à Morges, à pied, pour faire les répétitions de sa musique, armé seulement de deux morceaux de sucre, dans sa poche, et d'un carnet avec un pentagramme sur lequel il notait des motifs qu'il utilisait pour écrire des marches, des polkas, des scottish. Il avait sept fils qu'il avait formés à une éducation instrumentale. C'est-à-dire que chacun de ses fils jouait de deux instruments, un pour le bal et l'autre pour la parade. Dans mes années d'enfance, je passais tous mes étés à Mont la-Ville, souvent des étés très longs; c'est là que j'ai appris la clarinette avec un de mes oncles, et je jouais dans leurs bals, leurs musettes. [...]"
Seulement j'étais paresseux..."
[...] D'autre part, j'avais appris à Vevey le piano et le violon, et je faisais partie de la Fanfare des cadets de Vevey où j'ai appris à jouer de tous les instruments de cuivre. C'est vous dire que j'étais dans la musique d'emblée! Seulement j'étais paresseux. Ce qui m'arrivait lorsque je devais travailler mon violon, c'est que j'accordais mon violon au piano, et à ce moment-là, je posais le violon de côté, et je me mettais à improviser au piano. Et quand je faisais des exercices, j'en faisais autant: j'aimais mieux improviser au piano que travailler la technique. Manifestement, il m'était impossible de gagner ma vie avec la musique, puis que j'étais dans un état pareil. Alors je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de gagner ma vie dans l'enseignement des mathématiques puisque cela m'était très facile — j'avais une grande facilité de ce côté-là — et alors tu feras de la musique autre chose! [...]"
Ne pas devenir un musicien professionnel...
"[...] D'ailleurs un de mes professeurs à Vevey, M. Plumhoff, qui était un musicien allemand très, très fort, avait consenti à me donner des leçons d'harmonie gratuitement en me disant: Je te donne ces leçons gratuitement, parce que je sens que tu es doué, mais à une condition: tu vas me promettre de ne pas devenir un musicien professionnel, sinon j'arrête les leçons. C'est ainsi que je suis arrivé, assez jeune, dans l'enseignement des mathématiques. À ce moment-là, c'était assez facile de faire une licence. J'ai pu faire ma licence en mathématiques et sciences physiques en deux ans. À 20 ans, licencié, j'ai immédiatement obtenu un remplacement à l'Ecole normale de Lausanne, un remplacement assez dangereux puisque j'avais 20 ans, et que mes élèves étaient des jeunes filles qui avaient aussi 20 ans...Enfin j'ai été appelé au Collège, où je n'avais plus affaire qu'à des garçons. Et alors, au bout de trois ans, à peu près, j'avais économisé assez d'argent pour pouvoir me payer une année à Paris. À Paris (je vous raconte cela parce que ça peut intéresser les jeunes), j'ai fréquenté la Sorbonne, où je suivis des cours d'Appel, de Gourçat pour le calcul intégral et différentiel, de Poincaré, de Picard et d'Emile Borel. Et puis le Conservatoire, où je fréquentais des cours de contrepoint et d'histoire de la musique. Durant mon séjour à Paris, je me suis rendu compte que ma préparation en mathématiques était très en dessous de celle qu'exigeait la Sorbonne, et que je n'avais guère d'avenir dans ce sens-là. Et puis que ma passion pour la musique était beaucoup plus forte que celle des mathématiques. De sorte que je suis rentré à Lausanne, dans l'enseignement. [...]"
2. L' aventure des Cahiers vaudois...
"[...] Durant mon séjour à Paris, je me suis rendu compte que ma préparation en mathématiques était très en dessous de celle qu'exigeait la Sorbonne, et que je n'avais guère d'avenir dans ce sens-là. Et puis que ma passion pour la musique était beaucoup plus forte que celle des mathématiques. De sorte que je suis rentré à Lausanne, dans l'enseignement. C'est ici que je dois m'interrompre un instant pour parler des Cahiers vaudois. [...]"
Premier mariage, fait la connaissance de Ramuz
"[...] À Lausanne (encore un hasard) j'y suis rentré en automne 1906: le professeur d'arithmétique du Collège cantonal venait de mourir. Je postulai sa place, un concours eut lieu, et j'eus la chance d'être nommé. Je me suis marié peu après, jeune, et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Ramuz: ma femme — ma première femme — était une amie d'enfance de Ramuz qu'elle me fit rencontrer. Nous nous sommes tout de suite très bien entendus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'avais qu'une envie, c'était de composer de la musique; alors nous formions des projets: Ramuz m'envoyait des petits poèmes de Paris, et je les mettais en musique, nous avions une correspondance très suivie. [...]"
Une revue artistique vaudoise, les Cahiers vaudois...
"[...] C'est alors que Ramuz me dit son intention de former une revue littéraire, une revue artistique vaudoise. Tant qu'il était à Paris, c'était difficile, mais lorsque la guerre de 1914 le ramena à Lausanne, la question se posa; et c'est chez moi en quelque sorte que les Cahiers vaudois se sont fondés. Nous avions dans notre groupe Budry, Gilliard, René Morax qui nous est très cher, les deux Cingria, Alexandre et Charles-Albert qui étaient des amis de Ramuz, Spiess, Adrien Bovy et surtout Paul Budry, un être très entreprenant, un être qui aurait certainement été capable de laisser une grande oeuvre littéraire faite de romans ou de poèmes, un vrai poète... mais c'était un être profondément anarchiste et désordonné: aussi était-il brillant, éclatant dans la conversation et dans la vie, mais cela ne laissait pas beaucoup de traces, parce qu'il n'avait pas assez d'organisation. Alors tous ces garçons se réunirent chez nous. [...]"
Contre un milieu extrêmement conformiste...
"[...] La situation était la suivante: le canton de Vaud, et Lausanne en particulier, est un milieu extrêmement conformiste — aujourd'hui encore, il vit sur des conventions, sur des idées toutes faites, à ce moment-là, c'était très frappant. Aujourd'hui, une génération de littérateurs s'est formée, qui prend non seulement une attitude esthétique, mais une attitude politique: les littérateurs sont de gauche ou de droite, et le font sentir dans leurs oeuvres. Eh bien, voilà ce qui me paraît un trait caractéristique de notre groupe: nous étions complètement apolitiques. Nous ne savions pas ce qu'était la gauche et la droite, et nous nous occupions véritablement de l'art. Mais nous étions profondément, et tous, anticonformistes. C'était en cela que consistait notre révolte contre le milieu: ce n'était pas une révolte ouverte comme celle des gens de gauche, c'était simplement une attitude nettement négative devant le milieu. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, pour le Pays de Vaud, une littérature devait être faite avec de beaux sentiments, et que l'art devait avoir un but moral.
Notre mouvement a été, avant tout, une prise de position purement esthétique devant la vie et devant les choses, et cette prise de position avait un caractère régional manifeste: c'était le canton de Vaud, c'était le Valais...
Mais nous ne discutions pas de questions religieuses: nous étions à ce point véritablement orientés par notre amour pour l'art, pour chacun des arts que chacun de nous cultivait, que les autres questions disparaissaient. [...]"
Reproche aux Cahiers vaudois...
"[...] Ce qui nous paraissait nécessaire, c'était d'amener cette sorte de vérité, d'authenticité de l'art. C'est cela qui a été le caractère essentiel des Cahiers vaudois, c'est d'ailleurs le caractère essentiel de l'oeuvre de Ramuz.
Je reproche donc aux Cahiers vaudois de n'avoir été qu'un mouvement esthétique, et de n'avoir pas poussé ce mouvement plus loin, jusqu'aux questions politiques et surtout éthiques.
Remarquez par exemple que dans l'oeuvre de Ramuz, sauf peut-être dans ses tout derniers ouvrages ou dans son Journal, Ramuz n'a jamais pris position nette ni devant la question religieuse ni devant la question sociale ni devant la question politique. Il n'aimait pas la Suisse allemande, c'est entendu. Il pensait qu'il était Vaudois, qu'il était Romand: il ne savait pas ce que c'était que des Suisses allemands... des gens avec lesquels on était vaguement liés par des circonstances politiques; mais il était nettement antigermanique. Il prétendait ne pas connaître l'allemand, or il avait passé deux ans à Weimar, où il était le précepteur des enfants du comte Prozor. Par conséquent, je suis sûr qu'il le connaissait très bien, mais s'il était devant un Suisse allemand, il feignait de ne pas savoir un mot d'allemand. Il en était de même de la plupart des autres, d'ailleurs. Toujours est-il que cette attitude esthétique, essentiellement esthétique, put bien être ce qui a précisément opéré le rapprochement Strawinsky-Ramuz. [...]"
3. Lacerda, Kursaal Montreux, Strawinsky, Guerre de 1914...
Les «de Coppet»... Francisco de Lacerda...
"[...] Pour en revenir aux hasards de ma carrière, je vous disais donc que, si je n'avais pas été professeur de mathématiques, certaines choses ne se seraient pas passées. Effectivement, je n'aurais pas eu, parmi mes élèves au collège, les jeunes «de Coppet» dont le père avait une villa au bord du lac de Thoune. Ces de Coppet je peux bien vous en dire un mot en passant, étaient deux frères, d'origine vaudoise, dont l'un était agent de banque à New York, un grand mécène qui a été le fondateur du Quatuor du Flonzaley. L'autre, celui dont je vous parle, était de Nice. Il se vouait à la chimie et avait inventé la loi de cryoscopie. Il s'apprêtait à communiquer cette loi à un congrès, lorsqu'il lui arriva un très grand malheur: sa femme le quitta pour suivre un autre homme. Il en fut si accablé que pendant deux ans, il ne put plus travailler du tout car il était tout à fait déprimé, enfin bon à rien. Au bout de deux ans, il trouve une autre femme, il retrouve son équilibre et il se remet au travail et la première chose qu'il veut faire, c'est de se rendre à un congrès de chimie. Mais quand il arrive à ce congrès, il entend un savant allemand qui exposait la loi de cryoscopie qu'il avait, lui, découverte deux ou trois ans auparavant. C'était trop tard, le savant allemand lui avait volé sa loi. Ça l'a de nouveau déprimé et, alors, comme il s'était toujours occupé de musique, il décida de se vouer définitivement à la composition. Alors, il a invité au bord du lac de Thoune, dans sa maison, un violoniste, un pianiste et un violoncelliste pour faire de la musique. Et le pianiste se trouvait être Francisco de Lacerda, qui était le bras droit de David à la Schola Cantorum, et directeur des concerts de Nantes. C'était un chef d'orchestre excellent, qui, alors, revisait les compositions de M. de Coppet. [...]"
Lacerda au Kursaal de Montreux...
"[...] Or, comme j'avais ses deux fils dans ma classe, il m'a demandé (je ne sais pourquoi c'est moi qu'il avait choisi) de venir à Gunten passer l'été avec eux, pour préparer l'aîné de ses fils au baccalauréat et pour améliorer l'instruction mathématique du second. J'acceptai et je passai l'été dans ce milieu. Je me liai naturellement avec Lacerda, et comme j'avais, à Montreux, des parents par lesquels je pouvais obtenir quelque chose, je pus faire nommer Lacerda au Kursaal de Montreux. Naturellement, dès qu'il fut installé à Montreux, chaque fois que j'étais libre à Lausanne, je filais à Montreux pour assister à ses répétitions, et il était mon maître en matière de direction d'orchestre. C'était, à mon avis, un chef d'orchestre de tout premier ordre, qui serait beaucoup plus connu qu'il ne l'est, s'il n'avait pas été un homme aussi désordonné qui abîmait sa vie par son manque total de discipline vis-à-vis de lui-même. Il était le fils d'un ancien gouverneur des Açores, et avait beaucoup d'allure, beaucoup d'élégance. C'était un aristocrate. [...]"
L' apprentissage au Kursaal de Montreux...
"[...] Et c'est le fait qu'il était à Montreux qui me permit de lui succéder. Cette succession m'a été très favorable, parce que le travail consistait à diriger l'orchestre, sans répétition, tous les après-midi, pour les dames — les dames anglaises — qui prenaient le thé dans le jardin. On avait un énorme répertoire de musique légère, et pour perfectionner une technique de direction, tout cela était excellent. Et puis on avait tout de même, pendant l'hiver, chaque jeudi après-midi, un concert symphonique très sérieux, où j'ai eu l'occasion d'accompagner tous les grands virtuoses de cette époque: Pugno, Risler, Thibaud, Casals, etc. [...]"
Rencontre avec Strawinsky...
"[...] C'est ainsi qu'un certain jeudi après-midi, comme j'étais déjà féru de musique russe (j'en donnais souvent), j'ai vu arriver dans ma chambre un petit bonhomme qui s'est présenté, c'était Igor Strawinsky. Il s'était installé à Clarens en raison de la santé de sa femme, et il habitait juste dans la maison au-dessus de la mienne, où il était en pension.
Voilà donc encore un hasard, car sans cette rencontre de Strawinsky, je n'aurais pas rencontré Diaghilev, je n'aurais pas connu les Ballets russes et enfin, énormément de choses ne se seraient pas passées. Je me liai donc d'amitié avec Strawinsky et l'introduisis bien entendu aussitôt auprès de Ramuz et dans notre milieu des Cahiers vaudois, avec lequel il s'est senti, tout de suite, en profonde sympathie. Ramuz soutenait volontiers l'idée qu'on a trop l'habitude de diviser le monde par des parois verticales: il faut considérer les couches horizontales, disait-il, pour voir, par exemple, une couche paysanne qui se sent solidaire d'un pays à l'autre. Et c'est pourquoi un paysan vaudois et un paysan russe sont très proches l'un de l'autre. C'est ainsi que Ramuz et Strawinsky se sentaient tout à fait d'accord et qu'ils se rencontraient dans les mêmes goûts. Il en est né l'Histoire du Soldat, puis Renard, puis enfin toutes les oeuvres que Strawinsky a écrites à cette époque, et qui sont, je pense, celles de ses oeuvres qui resteront le plus longtemps. Donc, nous en étions là, en pleine effervescence des Cahiers vaudois, de l'amitié russo-vaudoise Strawinsky-Ramuz, et la guerre de 1914 est arrivée. [...]"
La guerre de 1914...
"[...] Lorsque la guerre de 1914 éclata, le Kursaal de Montreux a dissous son orchestre et je me suis donc trouvé sans emploi. Je suis retourné à Lausanne, j'ai de nouveau fait des offres au Département de l'instruction publique et j'ai repris des classes au Collège. [...]"
L' Association symphonique romande...
"[...] À ce moment-là, on a fait de moi un maître de classe. Cela n'a pas été très long, mais enfin cela m'a permis de vivre avec ma famille pendant un an. Les musiciens de l'Orchestre de Montreux étaient donc licenciés, ceux de l'ancien Orchestre de Lausanne aussi. Il y avait des tas de musiciens sur le pavé. Je me suis empressé avec eux de réunir un orchestre que j'appelai l'Association symphonique romande, avec lequel nous donnions des concerts à la Maison du Peuple de Lausanne, et puis que nous prolongions à Neuchâtel, Fribourg, etc. Au fond, c'était une première formule de l'Orchestre Romand. Les concerts d'abonnement de Genève, à ce moment-là, avaient aussi cessé. Tout le monde avait peur de la guerre, c'était effrayant: vous ne vous rendez pas compte de l'atmosphère qui régnait chez nous en 1914.
Lorsque j'avais fondé cette Association symphonique romande, j'étais allé à la Gazette de Lausanne dont j'avais été collaborateur, et dont le rédacteur en chef était un Monsieur Henri Burnier, littérateur d'ailleurs. Je lui avais demandé de faire un peu de publicité pour notre Association symphonique. Il me regarda et me dit: Monsieur, vous ne vous doutez pas que nous sommes en guerre. Je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est celui que Talleyrand disait aux musiciens de Vienne: Messieurs les musiciens, nous n'avons pas besoin de vous! C'est comme cela que j'ai été reçu à la Gazette de Lausanne en 1914! [...]"
Décès de Stavenhagen...
"[...] Enfin, nous avons continué tout de même. Et alors nouveau — mon Dieu, je n'ose plus dire hasard — mais enfin nouvel événement. M. Stavenhagen, ancien chef des concerts d'abonnement de Genève, est mort. Les musiciens de Genève décidèrent de poursuivre tout de même les concerts d'abonnement à leur compte, et invitèrent tous ceux qui pouvaient les diriger, à les diriger. Ils m'ont entre autres invité; et après ce concert, on m'a immédiatement proposé de prendre la succession de Stavenhagen. Cela n'a pas été tout seul, je dois vous le dire; mais finalement, enfin, cela s'est arrangé! [...]"
4. «Ballets russes», découvrir l'Amérique avec Diaghilev...
Les Ballets Russes...
"[...] À ce moment-là, les Ballets Russes avaient aussi interrompu leur activité. On ne peut pas se rendre compte de la révolution qu'a été, en 1908, l'arrivée des Ballets Russes à Paris, parce qu'elle a eu des répercussions fantastiques. On vivait jusque-là dans des mobiliers gris, ternes, ennuyeux, dans des décors de théâtre déteints. Tout à coup sont arrivés les Ballets Russes avec Shéhérazade, Carnaval, le Prince Igor et les décors de Bakst, les costumes de Bakst où il y avait un canapé vert avec un coussin rouge, avec des violets, des oppositions de couleurs tout à fait franches, et très violentes.
Cela a modifié le goût, et instantanément on a vu partout changer les costumes, changer les habitudes, changer tous les goûts.
Les Ballets Russes avaient fait fureur à ce moment-là, mais avec la guerre, ils ont dû arrêter leur activité. Diaghilev s'était réfugié en Italie. Un jour, il vient en Suisse, pour voir Strawinsky et lui dire qu'il a un contrat avec l'Amérique pour la saison 1915-1916, et qu'il cherche à y aller. Or, nouveau hasard, son chef d'orchestre, Monteux, était sous les armes. Alors Strawinsky lui dit: Mois j'en ai un pour toi, et il lui indique mon nom. Diaghilev vient à Genève, où je dirigeais les concerts d'abonnement à la suite de Stavenhagen; je lui ai convenu et il m'a demande d'aller faire cette tournée en Amérique. [...]"
Première saison avec Diaghilev...
"[...] Jusqu'à ce moment-là, le Comité des Concerts d'abonnement de Genève avait beaucoup hésité à m'engager. Mais lorsqu'on sut que j'avais été engagé par Diaghilev, on a prononcé ma nomination aux Concerts d'abonnement comme successeur de Stavenhagen! Ce fut ma première saison avec Diaghilev, et ça n'a pas été pour moi chose facile. Car si j'avais connu Strawinsky et vécu avec lui, dirigé l'Histoire du Soldat, si je connaissais ses oeuvres, je ne connaissais pas le reste du répertoire de Diaghilev. Je n'avais jamais vu les Ballets Russes, parce que je n'avais jamais pu aller les voir à Paris. Et tout d'un coup, je me trouvais dans l'obligation d'aller en Amérique faire une saison qui allait durer centcinq jours, où nous devions donner 105 spectacles dans 18 villes différentes, avec un immense répertoire: J'ai dû me mettre dans la tête toutes ces partitions en un clin d'oeil. Diaghilev m'a expédié quinze jours avant la troupe pour aller à New York préparer l'orchestre. J'ai trouvé un orchestre magnifique avec lequel nous avons fait la saison. Ce fut naturellement un très grand travail, mais très intéressant, parce que c'était la première fois qu'en Amérique on jouait des oeuvres de Strawinsky, et même beaucoup d'oeuvres russes, que jusque-là, on ne connaissait pas. [...]"
Une petite aventure...
"[...] J'ai eu deux petites aventures au cours de cette tournée que je veux vous raconter, parce qu'il s'agit de médecins. Nous avions donné des spectacles à Minneapolis, dans une salle qui était destinée à des matches de boxe, et qui pouvait contenir quelque chose comme 10'000 personnes. On avait arrangé une scène pour que l'on puisse donner le spectacle. Mais comme c'était au gros de l'hiver, il y faisait 14° au-dessous de zéro, il y avait des courants d'air épouvantables derrière cette scène, des courants d'air dans lesquels je devais rester pendant les entractes.
De telle sorte que quand nous sommes sortis — on prenait le train pour Saint-Paul, où on devait arriver, le lendemain matin — j'ai eu toute la nuit une fièvre qui montait de plus en plus: arrivé à Saint-Paul, j'étais tellement peu bien que j'ai cru ne pas pouvoir sortir du train. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai ramassé mes bagages et sauté dans un taxi pour me conduire à l'hôtel. Mais lorsqu'à l'hôtel on est venu apporter mes bagages dans ma chambre, on m'a trouvé par terre évanoui. Alors on a fait venir un médecin immédiatement; il a constaté une très forte fièvre, une angine violente, et il m'a dit tout de suite: Il n'est pas question que vous sortiez de votre lit pendant au moins une semaine. J'ai acquiescé du bonnet, mais le médecin était à peine parti que j'entendais, derrière la porte, Diaghilev (il se gardait bien d'entrer dans la chambre, car les Russes ont une terreur de la maladie) qui me criait: Ansermet, vous n'allez pas me faire faux bond ce soir. Alors je lui dis; Mais non, comptez sur moi, mais faites mettre un fauteuil devant mon pupitre.
Le soir, je suis parti en taxi, il fallait aller de Saint-Paul à Minneapolis. Il y a une certaine distance entre les deux, mais quand je me suis assis dans mon fauteuil, devant mon pupitre, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. C'était mon docteur qui m'a dit: Je suis là, n'ayez pas peur, je vous surveille. [...]"
Une deuxième aventure, le président Wilson...
"[...]Une autre aventure est celle qui m'est arrivée à Washington. Nous avions une grande soirée donnée au profit de la Croix-Rouge, et tout le corps diplomatique devait assister à ce spectacle, y compris le président Wilson. Diaghilev m'avait recommandé d'être à mon pupitre très tôt, pour pouvoir jouer l'hymne national à l'entrée du président Wilson. J'étais prêt, j'étais au pupitre, lorsque tout d'un coup un machinisme vient à la porte de l'orchestre et me dit: Monsieur Diaghilev vous demande d'urgence sur la scène. Il n'avait pas compris ce qu'on lui avait dit. J'ai cru que c'était vrai, je suis sorti, je suis monté sur la scène. Une fois sur scène, je n'ai pas vu Diaghilev; mais à ce moment-là j'ai entendu l'orchestre qui commençait tout seul l'hymne national. Alors, affolé, je me suis précipité hors de la scène pour aller rejoindre mon poste. Je ne pouvait y aller qu'en passant par la salle. A ce moment-là j'ai renversé quelqu'un dans le couloir; c'était le président Wilson. Je lui suis rentré avec la tête dans le ventre, c'était épouvantable!
Enfin, le reste de la saison ne s'est pas trop mal passé.
Après notre saison de Ballets russes en Amérique, nous avons rejoint l'Espagne: c'est le seul pays où l'on pouvait aller, et Diaghilev espérait pouvoir y donner des spectacles. À ce moment là, c'était dangereux parce que, vous le savez, les sous-marins allemands sillonnaient les mers. Nous avons dû prendre un bateau italien qui partait pour Cadix; nous étions les seuls sur ce bateau, qui faisait du transport de marchandises, ou des choses comme ça, mais où il y avait de quoi loger des gens. Je n'oublierai jamais cette traversée, parce qu'il fallait toujours être à côté de Diaghilev et lui tenir la main: il avait une terreur de la mer telle que c'était le premier voyage et le dernier qu'il ait fait, une terreur épouvantable. Il faisait tellement chaud qu'on passait les nuits sur le pont, sur des fauteuils, et il fallait être à côté de lui, Massine d'un côté et moi de l'autre, et l'encourager pour lui montrer qu'il n'y avait pas de danger. Bref, nous avons fini, sans encombre, par arriver à Cadix. Et lorsque nous avons débarqué, nous avons vu Diaghilev s'agenouiller et baiser la terre, en bon Russe qu'il était. [...]"
5. L'Espagne, rencontre avec Manuel de Falla...
Manuel de Falla
"[...] Nous sommes alors allés à Madrid, nous avons donné une série de spectacles au Théâtre Real qui est aujourd'hui brûlé, et nous y avons rencontré Manuel de Falla. Manuel de Falla, je le connaissais depuis avant la guerre, je l'avais rencontré à Paris. Manuel de Falla était un être exquis, d'une pureté absolue, d'une candeur... mais un malchanceux comme je n'en ai jamais vu: il se trouvait toujours dans des positions impossibles. Lorsqu'il est venu à Londres, le jour de la première du Tricorne, il a reçu un télégramme de Madrid lui disant que sa mère venait de mourir. Lorsqu'il arriva, il avait perdu les clefs de sa malle, il avait le frac dans sa malle et il n'avait point de frac pour la première, enfin il ne lui arrivait que des choses comme celles-là, à ce pauvre de Falla. Les hasards lui étaient le contraire de ce qu'ils étaient pour moi: les miens étaient guidés par une bonne Providence. [...]"
Chauve à Paris? Impossible!
"[...] Cela me rappelle une histoire assez comique: de Falla avait reçu une bourse du Gouvernement espagnol à la suite d'un concours, ce qui lui permettait de passer quelques années à Paris. Il a été à Paris environ de 1910 à 1914. Il était chauve et ses collègues de Madrid, pour lui faire une blague, lui avaient dit: Tu ne peux pas aller à Paris chauve! Ce n'est pas possible, tu dois mettre une perruque! Il s'était laissé convaincre et il avait, contre son gré, porté une perruque. Je l'ai vu à Paris, je ne me doutais pas que c'était une perruque, mais enfin, je l'avais vu avec ses cheveux. Alors lorsqu'en 1914, il regagna l'Espagne, dans le train, dans un mouvement de colère, en traversant un tunnel il ouvre la fenêtre et lance sa perruque hors du train, de telle sorte que quand il est sorti du tunnel, la dame qui était en face de lui le regardait avec de grands yeux, toute surprise de cette métamorphose. [...]"
«Alors, évidemment avec votre barbe...»
"[...] Nous avons passé à Madrid un temps assez heureux et je suis retourné, pour une saison, à Saint-Sébastien, en août. À Madrid, c'était extrêmement intéressant, parce qu'il y avait là une société internationale assez importante qui avait fui la France, enfin qui avait fui les pays en guerre, entre autres Mata Hari et Bolo Pacha. Je ne sais pas si vous connaissez ces personnages de réputation... Il y avait aussi la grande danseuse et chanteuse Pastora Imperio, qui avait été nommée la reine des Tziganes. Il m'est arrivé une anecdote très amusante avec cette Pastora Imperio.
Le roi Alphonse XIII était un homme assez léger, qui aimait beaucoup s'amuser et qui n'aurait rien sacrifié aux courses de chevaux. Pas aux courses de taureaux, mais aux courses de chevaux qui avaient lieu le dimanche. Or un jour, le ministère donne sa démission: on attendait avec impatience qu'un nouveau ministère se forme, et au lieu de cela, on apprend que le roi se promène aux courses de chevaux, à quelque distance de Madrid. Le public était furieux. Le dimanche soir, nous donnions une soirée de bienfaisance au Théâtre royal, à laquelle participaient les Ballets russes, et aussi cette Pastora Imperio que je devais accompagner à l'orchestre dans quelques chansons espagnoles.
D'habitude, lorsque le spectacle commençait, Alphonse XIII était toujours dans sa loge, avec la reine et les infants. Nous avions une fois été reçus par lui. C'était même assez drôle car quand il m'avait vu, il m'avait dit: Alors, évidemment avec votre barbe — j'avais à ce moment-là une grande barbe noire — avec votre barbe, vous êtes tout à fait Moscovite ! Je lui dit: Non, Monsieur... Majesté, je suis Suisse! Il se mit à taper sur ses jambes, en trouvant très drôle que ce soit moi, un Suisse, qui dirige les Ballets russes. [...]"
Diaghilev, à quoi servez-vous?
"[...] Et alors il demande à Diaghilev: Mais alors, qu'est-ce que vous faites dans la troupe? Vous ne dirigez pas, vous ne dansez pas, vous ne jouez pas du piano, qu'est-ce que vous faites? (*) Diaghilev avait de la peine à lui expliquer, et le roi lui offrit une cigarette. Diaghilev n'avait jamais fumé une cigarette de sa vie, de telle sorte que quand il prenait sa cigarette, il soufflait au lieu d'aspirer et éteignait l'allumette que le roi lui tendait. C'était assez embarrassant.
Bref, ce soir-là, le roi n'était pas dans sa loge il s'était attardé à la course de chevaux; lorsque, après le premier ballet et au milieu du numéro de Pastora Imperio, tout à coup, la loge s'ouvre et le roi entre. Immédiatement j'attaque l'hymne royal, mais cet hymne royal est couvert par les hurlements et les sifflets qui venaient des galeries, insultant le roi qui n'avait pas encore formé son ministère. Alors, à ce moment-là — cela était très beau — les deux infants se sont mis devant le roi pour le protéger: je les ai vus, les deux, se mettre comme ça, et le roi était derrière eux. Bref, les sifflets se sont tus, j'ai pu continuer. Puis Pastora Imperio a chanté une chanson qui se terminait par ces paroles: Y vivan los reyes que nos gobiernan! (Et vivent les rois qui nous gouvernent!) Et en chantant, elle s'est lancée vers la loge en faisant une grande révérence. Tout ce peuple qui venait de siffler a acclamé le roi et la famille royale, instantanément. Après cette saison-là, nous avons quitté l'Espagne pour l'Amérique du Sud... [...]"
(*) Dans une interview réalisée par la télévision suisse romande, Ansermet, rapportant la même anecdote, affirme que Diaghilev aurait répondu au roi: «Majesté, je suis comme vous: je ne travaille pas, je ne fais rien, mais je suis indispensable». Ceci est également cité dans le livre que Richard Buckle a écrit sur Diaghilev, voir par exemple cette page du site au-fil-des-lignes.forumgratuit.org.
6. Esquisse histoire ballet, Diaghilev, Cahiers Vaudois e.a....
Ernest Ansermet parle sans interruption depuis une quarantaine de minutes, il commence à être fatigué, ce qui est très compréhensible: il avait plus de 80 ans! Perdant un peu le fil de son discours, il ne suit plus l'ordre strictement chronologique. Mais c'est un jaillissement ininterrompu d'anecdotes, l'une entraînant l'autre, toutes savoureuses, avec beaucoup de souvenirs!
Diaghilev, les Ballets Russes, Picasso
"[...] Si ma vie a été conduite par des hasards, je ne suis tout de même pas resté esclave de ces hasards: je savais les limiter ou résister à ce qu'ils offraient pour moi. Déjà, dès cette époque, mes aspirations me poussaient à continuer mon activité à Genève, pour les concerts où j'avais été nommé, et de poursuivre, de les développer. Aussi je quittais Diaghilev à l'automne ou en été, et je le rejoignais au printemps, puisqu'à ce moment-là notre activité n'était qu'hivernale.
Alors cette année-là, au printemps, je le rejoignis à Rome. Diaghilev n'était pas riche, il ne l'a jamais été (quand il est mort, il ne restait que peu de chose sur son compte en banque...). Mais il vivait en grand seigneur, il tenait table ouverte et avait toujours à sa table des personnages intéressants, ou des grands personnages. Il était lié avec la noblesse de tous les pays, avec les diplomates: partout où nous allions nous étions entourés de diplomates; l'Aga Khan était un de nos amis et assistait régulièrement à nos spectacles. Il était très friand des danseuses, mais je dois vous dire tout de suite que cela ne servait à rien, nos danseuses étaient extrêmement sérieuses: je dois mentionner cela parce que les danseuses de ballet ont assez facilement une mauvaise réputation. Mais ce n'était pas le cas avec les Ballets russes, pour la simple raison qu'en Russie, l'art du ballet était un art admis dans la bonne société, c'est-à-dire que les demoiselles de bonne famille étudiaient la danse. Olga Koklova, par exemple, qui est devenue la femme de Picasso, était la fille d'un colonel et était d'une famille très bien. C'est aussi la raison pour laquelle Picasso a fini par l'épouser: quand nous étions à Rome, Picasso la poursuivait, mais elle ne se laissait pas faire. J'habitais dans le même hôtel qu'Olga Koklova. Picasso en profitait pour venir avec moi à l'hôtel, et puis au bout d'un moment, il me quittait et me disait: Je vais voir Olga. Il allait, mais moi j'entendais dans le corridor Picasso frapper à la porte; et Olga disait, de derrière sa porte: Non, M. Picasso, non, M. Picasso, je ne vous ouvrirai pas. Effectivement, il a dû attendre au moins neuf ou douze mois pour que, l'ayant présentée à sa mère et ayant promis de se marier à la mairie, elle accepte enfin d'être Madame Picasso.
Quand nous étions sur ce bateau italien qui nous ramenait de New York à Cadix, un beau soir, au moment où nous allions arriver à Cadix, le télégraphiste (j'allais toujours vers le télégraphiste pour écouter la radio, les nouvelles de la guerre) me dit: Ecoutez, Monsieur, venez donc dans ma chambre, je voudrais vous parler. Je vais dans sa chambre, il m'offre un verre de vermouth et me dit: Ecoutez, qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'allez pas me dire que c'est une compagnie de ballets! Parce que, moi, je sais ce que c'est, une compagnie de ballets, vous savez, j'en ai souvent transporté sur mon bateau. Mais là, j'ai essayé avec toutes vos danseuses, j'ai essayé de les séduire, mais il n'y a rien à faire. Il n'en revenait pas, ce Napolitain!
En 1917, nous étions attablés tous les jours à midi chez Diaghilev, avec Strawinsky, Cocteau, Bakst, Satie, Picasso. Picasso faisait les décors de Parade, Bakst préparait aussi un décor. Il y avait José Maria Sert qui préparait un autre décor... C'était véritablement des déjeuners éblouissants, imaginez que l'esprit de Cocteau était jaillissant, tout le temps! [...]"
En Amérique du Sud, le Théâtre Colon...
"[...] De là, nous sommes allés à Paris donner la première de Parade et un spectacle, et puis en Espagne. Ensuite, nous sommes partis pour l'Amérique du Sud. Nous y étions dans une situation épouvantable, parce que Diaghilev avait refusé de nous accompagner: il avait gardé avec lui Massine, son premier danseur, et nous n'avions que Nijinsky. Les directeurs du Théâtre Colon en avaient profité pour déclarer le contrat rompu, et quand nous sommes arrivés à Montevideo, ils sont venus nous dire: Vous pouvez reprendre le bateau et retourner en Europe. Comme ce n'était pas possible, ils déclarèrent: Alors, nous consentons à vous garder et à vous faire faire la tournée, mais à de toutes nouvelles conditions.
Les nouvelles conditions, c'est qu'ils paieraient Nijinsky tous les soirs avant le spectacle, mais que les autres ne recevraient, au bout de la semaine, que de quoi payer leur hôtel, avec un peu d'argent de poche. C'est tout ce que nous avons eu pendant toute la tournée, de sorte que nous sommes arrivés très appauvris à Barcelone, au retour. [...]"
Déclin des Cahiers Vaudois, des Ballets Russes, de Diaghilev...
"[...] À ce moment-là, j'ai quitté Diaghilev, jusqu'à la fin de la guerre. Et à la fin de la guerre, le ballet qui avait végété en Espagne a pu trouver des engagements à Londres: c'est là que nous avons connu les plus brillantes années des Ballets russes, de 1919 à 1923. Nous donnions des spectacles pendant quatre mois à Londres: toute la société anglaise, et l'élite anglaise, et les intellectuels d'Oxford et de Cambridge y assistaient. Durant les entractes des ballets, je dirigeais des morceaux de musique russe que les Anglais ne connaissaient pas, et nous étions constamment invités à des après-spectacles chez Lady Matthews, chez Lady Halifax, chez Mme Asquith et d'autres. Ce furent les grandes années
Ce fut vraiment là une période extrêmement importante, d'autant plus que c'est à ce moment-là que nous avons repris le Sacre du Printemps, et repris tous les anciens ballets des Ballets russes; créé le Tricorne, la Boutique fantasque, Pulcinella, Chout de Prokofiev, etc. Ces années ont été les grandes années.
En 1923, j'ai quitté Diaghilev, parce que je sentais que cela commençait à se dégrader. Ce que je vous ai dit tout à l'heure des Cahiers Vaudois, je pourrais le répéter, à plus forte raison, des Ballets russes. Les Ballets russes étaient une grande entreprise esthétique, qui a bouleversé les goûts et même les notions esthétiques, mais ce n'était que ça. Et si, vers la fin de ma vie, vous m'avez peut-être vu prendre une autre position devant l'art, et rechercher ce qu'il y avait derrière l'esthétique, ce qui se manifestait par l'esthétique, c'est peut-être bien une réaction à ce que j'ai vécu, soit chez les Cahiers Vaudois, soit chez les Ballets russes, une réaction au manque que je sentais dans cette attitude purement esthétique qui était la leur.
Cette attitude purement esthétique, je vous en donnerai un exemple typique. Les premiers ballets de Diaghilev avaient toujours un thème, une substance. Petrouchka, c'est une histoire ou un drame de marionnettes, mais enfin qui a le sens du drame humain. Le Sacre du Printemps, c'est la même chose, L'Oiseau de Feu, c'est la même chose; mais plus on s'éloignait, plus le sujet disparaissait, il n'y avait plus de sujet. On tendait à ne plus faire qu'un spectacle purement esthétique, et ce qui comptait, c'était le décor cubiste, fait en toile cirée, ou bien en verre, des costumes extravagants, et enfin une histoire qui ne tenait pas debout.
Lorsque nous avons donné Le Rossignol, par exemple: Le Rossignol de Strawinsky est écrit sur le conte d'Andersen que tout le monde connaît. Eh bien, quand je suis arrivé à Londres et que Le Rossignol était censément prêt, Diaghilev m'a dit: Mois dites-donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire du Rossignol? Il avait complètement oublié l'histoire du Rossignol!
L'histoire se termine ainsi: l'empereur est malade, il a gardé auprès de lui le rossignol japonais, qui est un rossignol mécanique; mais ce rossignol japonais s'est détraqué, et ne marche plus. Quand l'empereur est sur le point de mourir, le vrai rossignol revient vers sa fenêtre. La mort est là qui menace l'empereur, et le rossignol chante tellement bien les beautés du cimetière qu'il décide la mort à y retourner et à laisser l'empereur tranquille. De sorte que l'empereur est délivré de la mort. À ce moment-là arrivent tous les courtisans qui, eux, le croient mort. Et quand il se lève et leur dit: Bonjour, messieurs, ils sont tout à fait surpris. Donc, ça c'est très important; eh bien Diaghilev avait complètement oublié ce détail, et il croyait, lui, que l'empereur était mort! De sorte que le Bonjour, messieurs et toute la fin du ballet, n'avaient plus aucun sens. Mais cela ne le gênait absolument pas, pourvu qu'il y ait de la bonne danse.
Alors, tout ça, je le sentais, et je puis vous dire qu'après avoir quitté Diaghilev, c'est-à-dire après 1923, j'ai continué tout de même à aller le voir de temps en temps à Paris. Il m'a dit un jour: Je ne fais plus que de la saleté. Il était entraîné, emporté par sa propre tendance (ce que Strawinsky lui reprochait d'ailleurs à ce moment-là), par cette tendance esthétique qui consistait toujours à rechercher la nouveauté pour la nouveauté, ce qui n'avait pas de fin, et qui était en quelque sorte une dégradation de la véritable valeur de ses spectacles. Strawinsky le lui reprochait, je le sentais aussi, et lui-même s'en rendait compte... Il mourut en 1930 du diabète dont il souffrait depuis longtemps. [...]"
Anecdote à Buenos-Aires, une montre énorme...
"[...] Permettez-moi de vous raconter une toute dernière histoire: elle est vraiment très touchante. Lorsque j'avais été avec les Ballets russes à Buenos Aires en 1917, le théâtre Colon avait fait venir un orchestre brillant d'Italie pour les spectacles italiens, les opéras de Bellini, Donizetti, Verdi, Rossini, etc. Mais pour les Ballets russes qui jouaient Petrouchka, L'Oiseau de Feu et des oeuvres d'une haute difficulté, il avait pris des musiciens syndiqués de Buenos Aires, qui étaient, à part quelques excellents artistes, des musiciens tout à fait quelconques, de deuxième ou de troisième ordre, qui jouaient dans les cinémas ou les cafés.
Quand on a annoncé ça, toute la presse a protesté en disant: Ça va être affreux. Mais moi, j'ignorais ces circonstances, et j'ai pris les choses comme j'ai l'habitude de les prendre, j'ai travaillé avec un tel acharnement que les musiciens ont très bien joué, et que les spectacles ont parfaitement marché. Tout étonnée, la presse l'a reconnu, et a dit: Nous n'aurions jamais cru que cet orchestre soit capable de jouer comme ça. Et en reconnaissance, les musiciens m'ont invité à souper, à la fin de la saison, et leur chef m'a adressé la parole en me disant: Monsieur Ansermet, notre ambition est de former un orchestre argentin. On fait toujours venir ici des orchestres italiens, notre ambition est de former un orchestre avec des musiciens argentins et de donner des concerts, parce qu'il n'y a jamais de concerts à Buenos Aires, sauf de temps en temps l'orchestre de Colon. Et si nous arrivons à avoir les subventions nécessaires, nous espérons que vous viendrez nous diriger. Et là-dessus ils m'ont offert une magnifique montre en or. C'était une montre énorme!
Je suis rentré à Lausanne, je trouvais cette montre beaucoup trop grosse; je suis allé voir un horloger que je connaissais très bien, place Saint-François, qui était représentant d'une maison de La Chaux-de-Fonds. Je lui dis: Dites-donc, est-ce que vous croyez que je pourrais changer cette montre contre une montre, enfin, plus petite? — Oh, mon pauvre monsieur Ansermet, c'est de la camelote que nous fabriquons pour l'Amérique du Sud, elle ne vaut pas grand-chose, c'est notre maison qui l'a faite. Mais enfin, cela ne fait rien, je vous la changerai! [...]"
Les engagements à Buenos Aires, Juan José Castro
"[...] Quant à la promesse des Argentins, elle a été tenue car en cette année 1923 dont je vous parle, nous avions donné Les Noces à Paris. À la fin d'un spectacle, le concierge de l'Opéra vient me dire: II y a quelqu'un qui vous demande, et je vois arriver mon cher Juan José Castro, qui avait été mon violon solo à Buenos Aires, accompagné d'un autre musicien. Il me dit: Nous avons la subvention, et nous venons maintenant vous demander de venir à Buenos Aires. C'est ainsi que cela a commencé. J'ai fait dix ans de saisons à Buenos Aires: je dirigeais l'hiver à Genève, je partais au printemps et je revenais l'automne. De sorte que pendant dix ans, je n'ai pas eu d'été, mais cela ne m'a pas été si mal, vous voyez, je ne m'en porte pas trop mal. Sur quoi, je crois qu'il faut vous laisser vous reposer. [...]"
À noter que le texte de la causerie - un peu modifié - à fait l'objet d'une série d'articles du «Samedi litéraire» du «Journal de Genève» - mars et avril 1970 - ainsi que d'un tiré à part.
Voici donc...
Ernest Ansermet sur sa vie, une causerie tenue le 15 mai 1965 à Chambésy sur l'invitation du professeur René Mach
1. Je n'ai jamais pensé qu'à la musique 06:57 (-> 06:57)
2. L' aventure des Cahiers vaudois 06:45 (-> 13:42)
3. Lacerda, Kursaal Montreux, Strawinsky, Guerre de 1914 07:57 (-> 21:39)
4. «Ballets russes», découvrir l'Amérique avec Diaghilev 08:16 (-> 29:55)
5. L' Espagne, rencontre avec Manuel de Falla 05:54 (-> 35:49)
6. Esquisse histoire ballet, Diaghilev, Cahiers Vaudois e.a. 12:55 (-> 48:44)
Provenance: Radiodiffusion, archives Radio Suisse Romande
que vous pouvez obtenir en...
pour un téléchargement libre, depuis mon site
6 fichiers FLAC, 2 fichiers CUE (*) et 1 fichier PDF dans 1 fichier ZIP
(*) 1 fichier CUE pour les fichiers décomprimés en WAV et 1 fichier CUE pour les fichiers comprimés FLAC, si votre logiciel peut utiliser directement les fichiers FLAC.
Page de couverture de la brochure «Les grands Interprètes - Ernest Ansermet», Portraits de Jean Mohr, Texte de Bernard Gavoty, critique musical du «Figaro», Éditions René Kister - Genève
Ernest Ansermet en 1939, photo Roger Violet, Boris Liptnitzki
Ernest Ansermet en 1919, photo Julien, Genève
(La Patrie Suisse, 1919, No. 662, pp.32-33)
Ernest Ansermet en bateau pour l'Argentine, 1929
Photographe ?? si une personne visitant cette page devait en savoir plus, toutes informations m'intéressent -> Vos remarques!